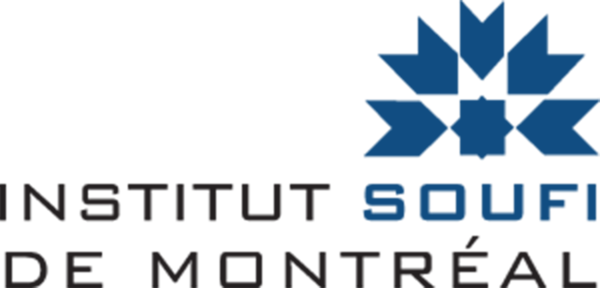L’empire du soufisme : l’État ottoman et le parrainage de la mystique de l’islam

Islam de paix
avril 13, 2018
Conférences
juillet 1, 2019
L’Empire ottoman a duré près de six siècles. Son étendue a couvert trois continents et autant de mers. Son exceptionnelle permanence dans le temps et sa dimension est aussi le miroir des nombreuses communautés religieuses, des langues et des cultures qui y existaient, gouverné par un État musulman. Longtemps considéré comme les champions de l’Islam, les Ottomans se sont vus taxés, au tournant du XIXe siècle de conservateurs rétrogrades, de fanatiques, attaché à une religion qui avait toujours fréné le progrès. Les drames du début du XXe siècle n’allaient pas tarder à confirmer ce qui était devenu le leitmotiv des Empires européens pour se partager les membres de « l’Homme malade », une expression qui s’est imposé durablement pour qualifier tout un pan de l’histoire de l’Islam. Pourtant, qui est témoin des vestiges nombreux et variés de cet empire gigantesque doit reconnaitre que les Ottomans ont atteint un des sommets de la civilisation…Quel est le moteur de cette ascension à la fois matérielle et spirituelle ?
Si l’état ottoman a été le patron des arts et de la culture au sens large, il n’a jamais cessé de parrainer la dimension intérieure de l’islam. Les Sultans se sont fait les promoteurs du soufisme, initiés eux-même à sa pratique, favorisant certaines tendances, en combattant d’autres. C’est en permettant l’épanouissement de la mystique que les Ottomans ont contribué au renouvellement d’une civilisation éprouvée par d’intenses bouleversements dans la période médiévale.
Cette intervention n’a pour but que de donner une observation globale de l’importance de la mystique musulmane dans la société ottomane du début de l’empire jusqu’à sa fin. Il sera question de la prégnance du soufisme dans la mise en place de la dynastie et de la contruction de l’État ottoman jusqu’à son importance dans les réformes de la période moderne et des conditions de son recul lors de la chute de l’Empire. Nous allons nous intéresser aux grandes figures spirituelles qui ont nourri et attirer le plus l’attention des voies les plus populaires mais aussi sur les conditions historiques qui ont permi à ces courants mystiques, à des confréries, de prospérer et ainsi, de façonner l’islam tel qu’il est pratiqué encore aujourd’hui. Car l’on mesure rarement l’importance de la sédimentation spirituelle qui s’est accompli au fil des siècles dans lesquels l’Empire ottoman a perduré. Pour les besoins d’une certaine cohérence dans notre propos, nous nous concentrerons ici sur les provinces centrales de cette empire ottoman, sur la dimension fondamentale de la capitale ottomane (principalement Istanbul à partir du XVe siècle) et des provinces les entourant directement à savoir la Roumélie et l’Anatolie, avec une attention particulière sur la notion de rayonnement, de diffusion voire de contrôle que ce centre a pu exercer sur le reste de l’Empire.
Les origines spirituelles de la dynastie ottomane
Un observateur de choix a visité l’Anatolie au moment même où l’émirat de la famille d’Osman, qui deviendront les « Ottomans », était au début de son expansion. Le célèbre voyageur tangérois, Ibn Battuta (m.1377), a donné dans le récit de ses voyages des informations précieuses sur une société en pleine effervescence. Fraichement passé à l’Islam c’est sur des territoires fait de rencontres entre des mondes parfois antagoniques que le soufisme s’épanouissait. Depuis la bataille de Manzikert (1071) victorieuse face aux Byzantins, les Turkmènes nomades apportèrent en Anatolie un islam loin des querelles doctrinales, une religiosité qui faisait « feu de tout bois » (un islam « métadoxe » au sens de Cemal Kafadar). Dans ce contexte favorisé par la présence de tendances variées, où l’État n’était pas l’arbitre de la conformité du dogme et des pratiques, l’unité des guerriers de la foi face à un monde chrétien sur le recul n’en était que renforcé. Ibn Battuta est témoin de ce phénomène et très admiratif de l’enthousiasme et de la générosité des populations de ces marche-frontières qui l’accueillent à bras ouvert. « Je n’ai pas vu dans l’univers » écrira-t-il « d’hommes plus bienfaisants qu’eux », en parlant des akhi. Car le fait confrérique, dont les akhi étaient la manifestation avait suivi l’expansion de l’islam en Anatolie. Les confréries majeures, importées d’Irak, de Syrie et du Khorassan tout comme des voies plus autochtones issues des Babas turkmènes poussés par l’invasion mongole essaimaient et ne céssèrent de peupler les zones frontières. Sur l’une de celles-ci, allait croître la principauté qui eu le plus de succès parmi les autres émirs musulmans. Celle d’Osman (m.1326) et de ses descendants avait un destin impérial. Selon un récit, élaboré certes des générations après le fondateur éponymes c’était un maître soufi nommé Edebali qui avait annoncé l’auguste destinée de son gendre. Le cheikh Edebali l’avait uni à sa fille après qu’Osman lui eu raconté un rêve qu’il avait fait alors qu’il était resté auprès de son maître dans la zawiya familiale. Les fondations de la dynastie ottomane reposaient alors sur une union à la fois spirituelle et temporelle dans laquelle la sainteté jouait un rôle tutélaire.
le tournant sunnite et l’ascendant d’Ibn Arabi
Pendant les deux premiers siècles de la dynastie ottomane, on constate un véritable foisonnement de tendances, de pratiques et d’idéologies en matière de foi musulmane. La pratique du soufisme y prenait des formes très variées : celle issu des grandes voies importées, organisées en confréries (tarikat) et soucieuses d’un équilibre entre loi (charia) et vérité (haqîqa) définie par un Ghazali (m.1111). D’autres mouvements plus prêts au mélange, provenant de la permanence du fond de religiosité turkmènes ou plus exposés à une culture chrétienne encore très prégnante dans certaines régions fraichement conquises, s’étaient également épanouis. Il ne faut pas oublier également le succès de courant malâmî, la « voie du blâme », manifesté par la présence en Anatolie de Qalandâr et de Haydarî. Ces adptes prêts à toutes sortes de provocation (nudité, scarification, consommation de stupéfiants, etc.) pour mener une vie intérieure sincère ont de toutes évidences proliférés dans un contexte particulier lors duquel la société avaient tendance à se conformiser rapidement. D’autres mouvements encore avait fait une place de choix au chiisme, sans que les sultans officiellement sunnites, n’en prennent ombrage. La dynastie ottomane, généreuse envers les voies mystiques de tout bords pendant les premiers temps de son expansion fut beaucoup plus scrupuleuse dans ses choix à mesure que grandit face à elle le péril du chiisme. La politisation de celui-ci, sous l’égide d’une autre dynastie- les Safavides- ayant d’ailleurs eux aussi des origines turkmènes et un lien avec le soufisme – fut l’un des moteurs de la « sunnisation » de l’Empire.
Jusqu’à l’avènement de la puissance safavide et de leur bras armé –les qizilbache (les « têtes rouges » en référence au turban rouges dont les adeptes se coiffaient)- qui évoluaient à l’intérieur même des frontière ottomane, les Sultans ottomans avaient dû faire face à plusieurs reprises motivés par des mouvements de type confrériques, regroupé autour d’un chef spirituel considéré comme infaillible. Ce fut le cas du mouvement d’insurrection lancé pa le cheikh Bedreddin (m.1420) lors de la plus grave crise de l’histoire ottomane. Après le passage de Tamerlan, qui avait brutalement mis fin à l’ascension fulgurante des Ottomans en 1402, la guerre civile qui éclata entre les fils du Sultan défait, avait profité à des groupes organisés en confréries qui contestaient la légitimité du pouvoir ottoman. Mehmed Ier (m.1421) réussit à grande peine à mater l’insurrection, ce qui posa pour la suite de la politique ottomane en matière de patronage spirituelle une double nécessité: celle de se concilier les confréries qui avaient en elle des ferments subversifs et celle d’encourager et de stimuler l’ascendant des confréries qui soutenaient fermement son pouvoir. C’était aussi extirper les mouvements les plus dangereux qui remettaient fondamentalement en cause l’existence de la dynastie ottomane et, par la même, l’équilibre de la communauté musulmane. Le véritable tourant sunnite de la dynastie s’est produite sous l’effet de deux tendances majeures : la lutte contre les chiites Safavides et la conquêtes des territoires arabes. Mais ce tournant s’est accompagné aussi par l’intronisation d’Ibn Arabi comme véritable « Saint patron des Ottomans » pour paraphraser l’expression de Riyad Atlagh.
En mettant un frein à l’expansion du chiisme des Safavides, les Ottomans, dirigés par le Sultan Selim (m.1520), faisaient main basse sur une grande partie du monde arabe. Ce double mouvement contribua à donner au pouvoir une ferme dimension sunnite. Celle-ci était renforcée par le statut de « Serviteur des deux sanctuaires » que le Chérif de la Mecque accordait au Sultan (le seul à pouvoir vraissemblalment arrêter les Portuguais qui se rapprochaient dans la Mer Rouge). En s’emparant de la capitale des Mamelouks défaits, la dynastie recevaient (et cela reste controversé) le titre de Calife, transmis par le dernier Abbassides qui avaient fui le sac de Baghdad par les Mongols en 1258.
Ce qui frappe dans les campagnes vicorieuses de Selim entre 1514 et 1517 c’est la relative rapidité des conquêtes. Hormis la victoire à l’Est sur le Shah Ismail (m.1524), de larges pans de territoires islamisés de longue date passaient sous l’autorité ottomane. Par contraste, c’est le temps relativement long que passa le Sultan à Damas. Des sources indiquent qu’il avait consulté un cheikh quelques temps avant la prise de la ville. Celui-ci lui aurait révélé l’emplacement du tombeau oublié d’Ibn Arabi, que le Sultan avait en grande estime. Des écrits prétés au cheikh al-Akbar (le « plus grand des cheikhs ») annonçait même ainsi l’événement : « Lorsque le sin (Sâlim) entrera dans le shin (Shâm, nom de Damas et de la Syrie) le tombeau de Muhyi l-dîn apparaîtra ». Selim ne s’était pas contenté de visiter à deux reprises les travaux d’érection de la mosquée et du mausolée dédié à Ibn Arabi que l’on peut encore visiter aujourd’hui. Il érigea le leg du cheikh al-Akbar en une source d’inspiration qu’il défendait par la loi. Il faut rappeler que les Damascènes n’avaient pas voué au grand saint le respect qui lui revenait. En délaissant sa tombe les citadins marquaient leur attachement la pensée de Ibn Taymiyya (m.1328) qui, un siècle après Ibn Arabi, avait contribué à détourner le regard sur un héritage spirituel considéré comme égaré sinon comme égarant (on oublie parfois que Ibn Taymiyya lui-même initié à la pratique du soufisme : la Qadiriyya) pour le commun des croyants.
Le lien de la dynastie ottomane avec le cheikh al-Akbar n’était pas nouveau. On peut même supposer que les Ottomans, se concevant eux-même comme les héritiers des Seldjoukides, considéraient Ibn Arabi comme un saint local, un saint d’Anatolie. N’avait-il pas épousé la mère de Sadr al-Din al Qonyawi (m.1274) lors de son instllation à Konya ? Sadr al-Din était, selom le célèbre voyageur ottoman Evliya Çelebi, un descendant de la dynastie seldjoukide. On peut aussi mentionner que plusieurs responsables du culte étaient les héritiers en ligne directe de l’enseignement du personnage.
Prospérité d’un soufisme d’État et premiers détracteurs
Le XVIe siècle est sans équivoque celui des grandes conquêtes ottomanes. Nous avons vu le cas de la prise des territoires arabes et les succès dans la lutte contre l’ennemi safavide qui motivaient d’ailleurs des insurrections en Anatolie selon une idéologie chiisante. Ajoutons les conquêtes du Sultan le plus connu de la dynastie, Süleyman Kanûnî (m.1566) – le Soliman le Magnifique des Occidentaux – qui s’empara de l’Irak. Il ne s’empêcha aucunement de faire la visite de figures vénérés par les chiites, les tombeaux de Ali et de Hussein. Il signifiait par là que ces illustres personnages n’étaient l’apanage des chiites safavides qu’il venait de déloger. Il ne faut pas oublier que les « gens de la maison » (ahl al-bayt) ont pour les soufis une place de choix, considérés, surtout Ali, comme les initiateurs au monde spirituel. Il faut croire que Süleyman, en bon disciple de la khalwatiyya qu’il était, ait cru bon de marquer ce geste de dévotion en grande pompe. Au cours de la même campagne, il faisait restaurer le tombeau de l’imam Abu Hanifa dont les Ottomans avaient adopté le rite juridique (madhab), consoldiant ainsi le choix de l’État pour le sunnisme. En matière de spiritualité, c’était le triomphe d’un soufisme sobre. La khalwatiyya allait faire des émules tout au long de la période classique avant d’être supplanté par la naqshbandiyya au début du XIXe siècle. Cette tendance à la recherche d’un équilibre entre loi (charia) et vérité (haqîqa). Dans ce contexte nombreux furent les savants, les juges, les jurisconsultes, que l’on considère trop souvent à tord comme ne manifestant qu’une orthodoxie « pure et dure », à vivre intensément une vie intérieure sous la guidance d’un cheikh. L’un des plus célèbre mufti de Süleyman, Ebu Suud (m.1574), était de ceux-là. On le connaît pour les nombreux procès pour hérésie qu’il organisa en son temps et au cours desquels le Sultan lui-même pu assister (de véritable procès « hallajien »). Le grand mufti n’en était pas moins un ardent défenseur du soufisme et n’hésita pas à critiquer vertement ses détracteurs. Une de ses fatwa (avis juridique) sur les khalwatis il écrivait :
« Il faut bien prendre garde au mensonge et à la calomnie et faire attention lorsqu’on achète au poids dans un endroit que l’on ne connaît pas (…) Dans cette confrérie, il existe des gens capables (…) On ne peut pas les accuser de blasphème (kufur). On ne peut pas reprocher à celui qui le fréquente le seul fait de les fréquenter »
Bien qu’elles restèrent longtemps des exceptions qui confirmaient une tendance de fond, les premières attaques virulentes contre la pratique du soufisme apparut lorsque l’expansion de l’Empire prit fin (à partir du XVIIe siècle). Le soufisme, nous l’avons suggéré au début de l’ascension ottomane, avait était un facteur déterminant dans la progression de l’Islam face à Byzance puis dans l’avancée en Europe orientale. Les aspirants au soufisme étaient généralement en premières lignes sur les frontières, toujours prêts à s’installer sur de nouveaux territoires (les « derviches colonisateurs » décrits par Y. Ocak) ou pour motiver les troupes et prendre soin des hommes au front. La khalwatiyya fut ainsi très présente dans les Balkans et y reste la voie la plus importante en terme de disciple jusqu’à ce jour. Noublions pas non plus que l’armée d’élite des Ottomans, celle qui fit trembler l’Europe à deux reprises aux porte de Vienne, les « Janissaires », avaient pour saint patron un saint local appelé Hadji Bektache (m.1271) dont le nom est encore très familier dans la Turquie contemporaine. Bien qu’il fasse partie de cette tendance moins regardante sur la loi issue du patrimoine bigarré de l’Anatolie, le patronage d’une armée faite de chrétiens islamisés n’était pas tout à fait du hasard. La permanence de voies qu’on pourrait qualifier de borderline comme le bektachisme, était aussi un moyen pour l’État de laisser s’exprimer quelques écarts pour mieux contrôler et orienter sa politique interventionniste en matière de culte.
Ceux qui s’en prirent aux pratiques des soufis visaient leurs aspects les plus spectaculaires : le devran des halvetis, qui tournent lors de leur invocation en cercle, les circombulations et le sama’ des derviches tourneurs de la mawlawiyya sans oublier l’utilisation de la musique, des références à la théophanie d’Ibn Arabi (surnommé le cheikh al-akfar, le « plus infidèle des cheikhs » !) et des thèmes évoquant l’ivresse que donne le vin… Il faut voir dans les attaques des Kadızadelis-le nom donné aux adeptes de cette tendance rigoriste apparut au XVIe siècle mais qui s’amplifia au XVIIe siècle- un certain dépit face à un véritable establishment soufi dans l’exercice du culte. Ce phénomène témoigne une fois de plus du patronage de l’État en matière de religion à travers laquelle la mystique occupait une place de choix.
L’autre charge contre le soufisme, allait venir du désert. Les partisans d’al-Wahhab et leur mouvements littéralistes s’attaquèrent à l’Empire ottoman en visant sa base : l’attachement à la dimension intérieure de l’islam manifesté par le culte des saints. Plus tard, ils viseraient l’immense travail d’exegèse des grandes œuvres mystiques comme celle d’Ibn Arabi ou de Jalal al-Din Rumi et les rejeteront comme tout autant d’innovations blamâbles (bid’at). Bien que les Ottomans réussirent, non sans mal, à venir à bout d’un péril qui menaça direcetement les villes saintes, la pression wahhabites allait s’accroitre pour finalement remplacer l’hégémonie ottomane sur le monde musulman et nous donner, jusqu’à aujourd’hui, une idée de ce que le parrainage spirituel est suceptible d’engendrer.
Les réformes ottomanes et la fin de l’empire du soufisme
On associe souvent les réformes ottomanes, amorcées à la fin du XVIIIe siècle, avec occidentalisation. L’État ottoman, forcé de se mettre au diapason face à des Empires européens en pleine expansion et mobilisant tout le progrès technique pour servir la conquête, aurait tourné le dos à sa tradition pour évoluer dans le même sens que ses adversaires. Or, des recherches récentes montrent que le siècle des réformes, celui des Tanzimat, de la Constitution ottomane, de la modernisation, est un moment où la pratique du soufisme n’est pas délaissé par les tenants de l’État, bien au contraire. Elle est même tout à fait encouragée, étant perçu comme un moyen de restaurer la gloire de l’Islam et par la même occasion, la puissance de la dynastie. Selim III, l’audacieux sultan du Nizam-i Cedîd, la nouvelle armée modernisée dont les Janissaires avaient tant pris ombrage, n’en était pas moins un disciple de la Mawlawiyya qui nous a laissé des poèmes mystiques encore déclamés aujourd’hui en Turquie. Le dernier Sultan Mehmed V était lui aussi un adepthe de la voie de Mawlanâ.
Le XIXe siècle est l’heure de gloire de la voie naqshbandiyya. Cette voie, connue pour son zèle à viser les dirigeants pour redresser par ricochet la communauté entière des croyants, eut, dans la première moitié du XIXe siècle, l’adhésion générale du gouvernement. De nombreux gouverneurs envoyés dans les quatre coins de l’Empire en étaient les adpetes. Abd al-Majid Ier, l’initiateur des grandes réformes des « ré-organisations » (les Tanzimat), promoteur du rescrit de Gülhane, n’en était pas moins un fervent naqshbandî.
Il ne faut pas oublier non plus l’importance du soufisme dans les nombreux mouvements de résistance contre les multiples invasions européennes. La résistance locale venaient à coup sûr des milieux confrériques et cherchaient à mobiliser l’assistance de l’État ottoman sur la base d’une fraternité spirituelle. Nous en eurent des exemples saillants avec la Naqshbandiyya du cheikh Shamil (m.1871), luttant contre les Russes dans le Caucase, la Sanussiyya en Lybie contre les Italiens, ou bien encore Abd al-Qadir (m.1883) et la mise en place d’un État chérifien dans une Algérie autrefois ottomane pour faire rempart à la France dans la première moitié du XIXe siècle.
Ce dernier allait d’ailleurs avoir un rapport étroit avec l’État ottoman après sa détention en France puisqu’il s’installa dans l’Empire et y finit sa vie. De Bursa à Damas, l’ancien émir se consacra dans une entreprise de revivification du travail d’Ibn Arabi, avec qui il nourrissait des liens intimes, scripturaires et bien au-delà. Au delà des oppostions politiques propre au contexte hoouleux de l’époque, on peut penser que les Ottomans considéraient avec beaucoup d’intérêt et de respect le travail d’un chérif (descendant du Prophète) si célèbre en son temps qui peuvrait pour la connaissance de leur « saint patron ». Rayonnant depuis Damas, l’œuvre d’Abd al-Qadir résonne profondément jusqu’à aujourd’hui et l’on se doute bien que le patronage soufi des Ottomans ait pu contribuer favoriser ce renouveau de la pensée d’Ibn Arabi. Le plus célèbre Sultan de la fin de l’Empire Abd al-Hamid II (m.1918) que l’histoire a communément retenue comme le « Sultan rouge » du fait de tribulations politiques malheureuses, n’en était pas moins un moderniste tout autant qu’un aspirant au soufisme. Il ne retenait pas moins de trois affiliations confrériques. Entourés par des maîtres spirituels naqshbandî et rifa’î (le fameux Abu’l-Huda al-Sayyadi), il était aussi initié à la qadiriyya.
La mort de l’Empire ottoman consacré par la mise en place de la République par Mustafa Kemal « Atatürk », entraina, dans les frontières de la Turquie actuelle, la déchéance du soufisme. La fermeture des zawiya (ou tekke) et l’interdiction de tout ce qui nuire à ce que le réformateurs considérait comme la voie du progrès, contraint les aspirants du soufisme à l’exil ou à la clandestinité. C’est ainsi que la Mawlawiyya de la maison mère de Konya se transplanta pour la Syrie voisine et que, de là, Hamza Shakûr (m.2008) put transmettre au monde entier les émanations de Rûmi. Mais pour la Turquie, le tournant était plus radical. Un voyageur français qui voyageait peu après la mort du « père des Turcs » constatait, en visitant Konya, qu’il n’y avait pas l’ombre d’un derviche tourneur. Les danseurs sur eux-mêmes finiraient par revenir mais avec, dans leur cortège, une forte dose de folklorisme qui a peu avoir avoir le détachement intérieur dont sa pratique est l’invitation. Aujourd’hui, le soufisme reste en Turquie une réalité dans la pratique de l’islam lui-même, tellement la sédimentation de la tradition soufie a été importante. Toutefois la véritable pratique demeure quelquechose de caché. Nombre de jeunes gens ignorent l’importance de la tradition mystique, l’importance de la guidance spirituelle. Toutefois, la production cinématographique turque (on ne saurait que conseiller l’ecellent film intitulé Somuncu Baba, le secret de l’Amour, sorti en 2016) montre que les temps sont en train de changer et que l’écho des temps ottomans résonnent encore
Sylvain CORNAC
Bibliographie
ABU MANNEH, Butrus, «The Naqshbandiyya-Mujaddidiyya in the Ottoman Lands in the Early 19th Century», Die Welt des Islams, 22, 1982, p1-36.
CLAYER, Nathalie et VEINSTEIN, Gilles, le soufisme dans l’Empire ottoman dans Alexandre Popovic et Gilles Veinstein (dir.), Les voies d’Allah : les ordres mystiques de l’islam des origines à aujourd’hui, Paris, Fayard, 1996.
CURRY, John, The Transformation of Muslim Mystical Thought in the Ottoman Empire : the Rise of the Halveti Order, 1350-1750, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010.
GEOFFROY, Éric, Initiation au soufisme, Fayard, 2003.
IBN BATTUTA, Voyages. tome II De la Mecque aux steppes russes et à l’Inde, traduit par Defemery et Sanguinetti (1858), introduction et notes par Stéphane Yerasimos, La découverte, réed. 2012.
KARAMUSTAFA, Ahmet, God’s Unruly Friends: Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period, 1250, 1500, Salt Lake City, University of Utah Press, 1994.
TASBIHI, Eliza, « The Mevlevî Sufi Shaykh Isma’îl Rusûkhî Anqarawî (d. 1631) and his Commentary on Rûmî Mathnawi » Mawlana Rumi Review, vol. 6, 2015.
VEINSTEIN, Gilles, « Retour à Salihiyya : le tombeau d’Ibn Arabi revisité », Autoportrait du Sultan ottoman en conquérant, éditions Isis, Istanbul, 2010.